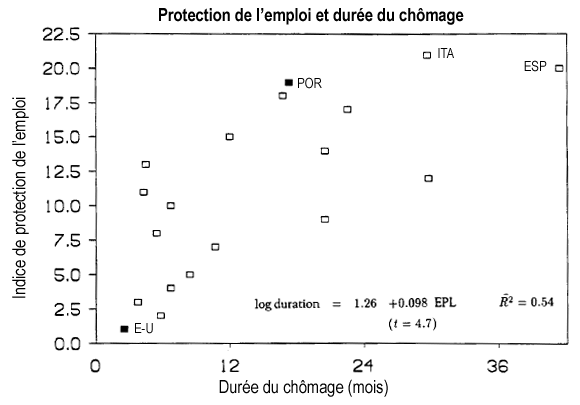La protection de l’emploi, c’est-à-dire l’ensemble des obligations des entreprises et des salariés en jeu lorsqu’il est mis fin à un emploi (Blanchard et Tirole [2001]), figure parmi les facteurs souvent cités comme causes du chômage en Europe. Voici les résultats de quelques études à ce sujet.
Influences mesurables : flux et durée du chômage
Ces deux figures, tirées de Blanchard et Portugal [1998], montrent les effets de la protection de l’emploi sur le flux travail-chômage et la durée moyenne du chômage, respectivement. L’indice de protection de l’emploi (EPL dans la régression) est un classement tiré de l’étude
OECD Jobs Study. Le flux et la durée moyenne du chômage sont des moyennes prises sur 1985-1994.

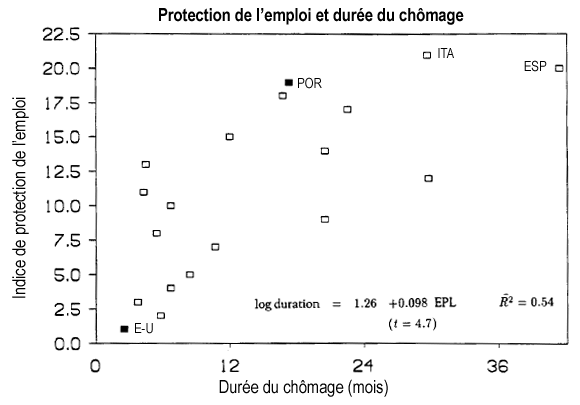
La première figure montre une nette relation négative entre protection et flux, la seconde montre une nette relation positive entre protection et durée du chômage (mais on aurait aussi une relation positive avec la durée moyenne d’emploi).
Impact sur le taux de chômage
En fait, les deux effets précédents tendent à s’annuler : à partir de ces données, Blanchard et Portugal [1998] trouvent une corrélation de log(chômage) sur EPL quasi-nulle (0,023 et t=1,3). En particulier, le Portugal et l’Espagne ont des niveaux de protection très proches (19 et 20), mais des taux de chômage très différents (6,8% et 23,8% en 1994, d’après OCDE [2001]).
La protection n’explique donc pas à elle seule le taux de chômage, mais elle limite le flux d’embauches. En rendant le marché du travail plus "stagnant" ou "sclérosé", la protection freine la réallocation entre emplois nécessaire à l’efficacité et contribue à maintenir le chômage à des niveaux élevés (Blanchard et Tirole [2001]).
Par ailleurs, ces résultats restent valides quand on tient compte d’autres institutions du marché du travail, comme la générosité des allocations chômage et les procédures de négociation salariales (Nickell [1997]).
Peut-on influer sur le taux de chômage en s’attaquant à la protection de l’emploi ? Voici une figure de Morgan et Mourougane [2001], qui compare l’évolution du taux de chômage (u) entre 1979 et 1997 avec l’évolution de la "sécurité de l’emploi", mesurée par un indice "ESSI". Cet indice est construit à partir d’enquêtes auprès des firmes, en leur demandant si le manque de flexibilité pour licencier était un obstacle à l’embauche. Les mesures ont été faites en 1985, 1989 et 1994. Morgan [2001a] a montré que ces résultats d’enquêtes étaient représentatifs du niveau de protection de l’emploi.

Il n’y a pas de relation claire entre les deux. Cela n’exclut pas que des réformes ciblées sur certains aspects de la protection puissent avoir un effet (voir Blanchard et Tirole [2001] pour quelques pistes).
Les indices de protection sont-ils fiables ?
Ce tableau tiré de Morgan et Mourougane [2001] montre les résultats et classements de quelques pays selon trois indices de protection :

Certaines tendances sont stables (le R-U a un faible niveau de protection), mais en général il est difficile de classer les niveaux de protection. Cela fragilise les résultats de Blanchard et Portugal [1998], qui utilisent un classement, et qui devraient être reproduits avec d’autres classements.
Références
- Blanchard et Tirole (2001) : Protection de l’emploi et procédures de licenciement, la Documentation Française.
- Blanchard et Portugal (1998) : What Hides behind an Unemployment Rate : Comparing Portuguese and U.S. Unemployment, NBER W6636.
- Nickell S. (1997) : « Unemployment and Labor Market Rigidities : Europe versus North America », Journal of Economic Perspectives, n° 11(3), pp. 55-74.
- OCDE (2001) : Statistiques rétrospectives de l’OCDE, 1970-2000, OCDE.
- Morgan et Mourougane (2001) : What Can Changes in Structural Factors Tell Us about Unemployment in Europe ?, Working Paper no. 81, ECB.
- Morgan, J., (2001a) : Employment protection and labour demand in Europe, forthcoming in Applied Economics.